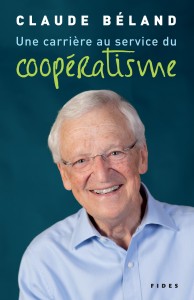
Une carrière au service du coopératisme est paru chez Fides, un ouvrage de 288 pages au coût de 29,95 $ – ISBN: 9782762138856
À 84 ans bien sonnés, l’ancien président du Mouvement Desjardins n’a de cesse de sillonner le Québec pour vanter les bienfaits du coopératisme et de la solidarité. Entrevue avec un éveilleur de conscience à la foi inébranlable.
Claude Béland, comment résumer en quelques mots votre carrière?
Je voulais être un professionnel de la justice. Sous l’influence du milieu dans lequel j’ai été éduqué, avec des principes d’égalité, de fraternité, de partage, la pratique du droit ne me satisfaisait pas; le résultat est conforme à la loi mais pas nécessairement à la justice. Finalement, j’ai travaillé 60 ans dans le monde de la mutualité et des coopératives.
De nombreux prix et mentions témoignent de votre grand humanisme. Vu l’état de la société actuelle, les valeurs qui vous sont chères semblent avoir disparu. Comment demeurer optimiste?
On est dans un monde d’incohérence. À la suite de la deuxième Grande guerre mondiale, on a créé l’ONU et on a rédigé une nouvelle Déclaration des Droits de l’Homme. On y parlait d’égalité, de dignité. Tous les pays membres ont unanimement défini le projet de société mondiale. La social-démocratie répondait à cela. On est passé ensuite à une économie au service non plus de la nation ou de la collectivité mais à celle des individus. On vit ça pleinement, avec les résultats que l’on connaît. Je suis heureux d’avoir eu la chance de travailler durant toute ma carrière avec des groupes de gens qui eux, voulaient vivre la démocratie, l’égalité et la fraternité. Cela maintient l’espoir qu’un jour, on arrivera peut-être à ce que nous promettaient les belles déclarations des Droits de l’Homme.
Au Mouvement Desjardins comme ailleurs, vous n’avez jamais été adepte de la langue de bois. En début de carrière, vous vous êtes même fait qualifier de « jeune avocat impertinent ». Faut-il être impertinent pour arriver à se faire entendre?
Je pense que oui. Aujourd’hui, quand vous tenez un langage humaniste, on vous considère comme si vous étiez dépassé. Regardez ce qu’on enseigne dans nos écoles de gestion : le rendement, les grands profits. Vous avez réussi votre vie si vous parvenez à être très riche. Quand on sait que le 1% de la population aux États-Unis et même au Canada détient plus de la moitié de la richesse totale, on ne peut certainement pas parler d’un monde qui a compris que si on veut vivre en harmonie, il faut mieux partager ce que la planète nous offre. Il y a beaucoup de travail à faire. Tant qu’on ne règlera pas ça, ça va être la lutte pour la vie et non l’union pour la vie, comme le disait Alphonse Desjardins. Et ça, ça se fait par la solidarité, ça m’apparaît évident.
L’autonomie et la hiérarchie n’ont jamais fait bon ménage. Il semble que vous en ayez fait les frais chez Desjardins. Comment convaincre que la fusion fait la force?
Desjardins a été une des victimes de ce basculement des valeurs fondamentales du monde. Quand j’ai été élu président, y’avait des gens parmi les plus riches qui étaient venus me voir en disant : « Pourquoi vous ne nous payez pas des taux d’intérêt plus élevés, nous qui vous apportons beaucoup d’épargne? » À l’époque, au nom de l’équité, on donnait le même taux d’intérêt à tous les membres, qu’ils aient 1000 $ ou 100 000 $ comme pécule. À l’origine, cet argument-là était bien reçu mais déjà quand j’ai été élu président, les valeurs ont commencé à changer. Les plus riches avaient décidé qu’ils méritaient davantage. Depuis, le monde ne cesse de glorifier la richesse. L’être humain est un être global et ceux qui veulent être partie prenante du champ économique doivent connaître les conséquences politiques et sociales de l’exercice de l’industrie ou du commerce qu’ils adopteront. C’est pour cela que dans les facultés de gestion de certaines universités, on retrouve les sciences sociales, politiques et économiques.
Quand on sait le succès et la force du coopératisme, pourquoi devoir se battre pour en faire la promotion?
L’année 2012 a été proclamée Année internationale des coopératives par l’ONU, ce n’est tout de même pas rien. On n’ignore pas la coopérative, mais ce n’est pas inscrit dans le système dominant. On la considère comme un à -côté. Comme l’économie des pauvres. Malgré tout, il s’en forme de plus en plus parce que les gens savent très bien qu’avec le système actuel, on s’en va nulle part. Et c’est là que le politique doit intervenir. Il y a des millions de gens qui sont membres de coopératives.
Vous vous déclarez partisan d’une éthique du bonheur collectif. Avez-vous une recette à nous communiquer?
J’ai fait une vie très heureuse parce qu’il y a beaucoup de joie à rendre service aux autres et à contribuer à l’égalité. L’égoïsme procure peut-être des plaisirs, mais ils ne sont pas profonds. Je pense qu’on tire beaucoup de satisfaction à réaliser que ce qu’on fait aide les gens à vivre une vie digne. C’est la récompense première.
Dans votre plus récent ouvrage, vous indiquez que la coopération est le résultat de l’union de trois éléments : l’autonomie, la démocratie et la solidarité. À ce chapitre, le Québec d’aujourd’hui fait piètre figure, non?
C’est peut-être plus frappant au Québec parce qu’il y a eu une longue période avant les années 60 où les valeurs religieuses étaient très présentes, résultat de la Conquête en 1760, où le Roi d’Angleterre a permis de conserver notre langue et notre religion mais où on n’avait pas le droit de toucher au monde des affaires, réservé aux Anglais. Pendant deux siècles, ils étaient propriétaires d’à peu près tous les commerces. On a longtemps grandi dans un encadrement qui nous incitait à des valeurs de solidarité, de partage. C’est comme ça que se sont créés les fonds de secours, les mutuelles, les coopératives. Même si elle était majoritaire, la population québécoise n’avait d’autre choix que la solidarité. Avec le basculement du monde, causé par l’évolution des technologies, les communications et les moyens de transport plus faciles, ce qui devait rapprocher les peuples et les continents, a surtout rapproché les marchés. Aujourd’hui, le pouvoir économique est plus puissant que ceux de la société civile et du pouvoir politique.
Selon vous, le premier défi à relever pour aspirer à une société plus juste demeure l’éducation au savoir-être. Quelle voie préconisez-vous?
Aujourd’hui, accumuler des fortunes, adorer l’argent, est devenu une vertu. Si on veut changer ça, il faut connaître l’histoire, savoir d’où on vient et pourquoi le monde est ainsi. L’être humain est d’abord un animal. Il devient humain par l’éducation. Tous les humains ont certains instincts de domination, de possession, d’exploitation des ressources dont il peut profiter. Si on le laisse à ses instincts, ça devient un animal dangereux.
Comme un nombre grandissant d’observateurs, vous avancez que la réforme des institutions démocratiques est urgente. Comment pousser nos élus à aller de l’avant?
Les gouvernements dépendent désormais du capital. Les gouvernements sont endettés, les individus sont endettés. Les banques font des affaires d’or. Le service bancaire est devenu l’industrie la plus payante qui soit. La Banque de Montréal a fait cette année près de deux milliards de profits. Le président n’est pas content. Il va mettre 500 personnes à pied parce qu’il veut faire plus. Je ris pour ne pas pleurer. Quand il y a eu le grand crash aux États-Unis, le président Obama a été obligé de sauver les banques. Autrement, tout le monde aurait été en faillite, même au gouvernement. La démocratie est en crise. Vient un temps où les gens se disent : « On ne peut pas compter sur les détenteurs de grands capitaux. Est-ce raisonnable qu’un patron de banque gagne 300 fois ce que gagne la moyenne de ses employés? Ça n’a aucune justification logique. » C’est ce qui mène à de grandes révolutions.
Croyez-vous qu’il soit possible de renouveler la participation citoyenne? Si oui, comment?
Il y a un peu d’espoir. Dimanche dernier, je me suis retrouvé devant des gens appartenant à un groupe d’économie sociale. Ils sont convaincus qu’ils ne peuvent pas faire mieux de leur vie que de pratiquer les vertus que proposent les coopératives, les mutuelles, les organismes sans but lucratif, des entreprises qui s’inspirent des valeurs qui ont été votées par tous les pays à l’ONU quand ils ont écrit la fameuse Déclaration des Droits de l’Homme. Il y a 10 jours, j’étais à Saint-Pascal-de-Kamouraska, dans une école internationale qui enseigne la social-démocratie. Là -bas, on ne veut pas nécessairement former des entrepreneurs, on veut faire des bons citoyens.
D’après vous, la recette patronat-syndicat est-elle périmée?
Tout à fait. Mais la solution est en grande partie entre les mains des patrons. Il n’y a pas longtemps, les syndicats demandaient qu’on augmente le salaire minimum de cinq sous de l’heure. Ce n’était pas catastrophique. Qui s’est objecté? Les chambres de commerce, les grands patrons. Eux n’ont pas hésité à se donner des augmentations de salaire de 50, de 100 et même de 200 %. Au niveau du patronat, on n’est pas très sensible. Si les plus puissants ont accumulés des milliards, c’est parce qu’ils n’ont pas fait beaucoup de concessions.
Vous écrivez: « Un pays ne peut être créé par un peuple divisé. » Dans les circonstances, croyez-vous que le Québec peut encore atteindre à la souveraineté?
Actuellement, les gens sont tellement fragiles! Dans toutes les campagnes de référendum, on leur a fait peur en disant : « Vous allez perdre vos pensions, vous serez obligés de baisser votre niveau de vie. » Quand j’étais président du Mouvement Desjardins, le premier ministre Bourassa m’avait nommé sur la Commission sur l’avenir constitutionnel du Québec. On avait conclu qu’il fallait faire un référendum. Desjardins s’était même prononcé en faveur de l’indépendance. Un peuple qui veut survivre doit avoir le pouvoir de décider de son avenir, faire ses propres lois et ses traités avec ses voisins. S’il ne les a pas, il devient un partenaire. Mais quand on est une province parmi 10 autres, on décide de moins en moins. Le Québec est ouvert à la social-démocratie. Nos racines sont sociales-démocrates. Ça nous est naturel. Mais on ne peut pas le vivre parce qu’on est dans un monde dominé par le néo-libéralisme. En Europe, ils ont fait le marché commun. On disait à des petits pays comme la Grèce, l’Italie, la Croatie : « Venez avec nous, on va faire une grande fédération. » Regardez ce qui arrive. La Grèce dépend de la France et de l’Allemagne et ne décide plus de grand-chose. Les grands s’imposent et imposent leur façon de voir aux moins nantis. Je pense que le Québec gagnerait à être un pays pour décider de son propre avenir puisqu’il est distinct. Même le Canada le reconnaît. Sauf qu’il ne suffit pas de le dire, il faut aussi lui donner les moyens de conserver sa distinction et ça, ça ne semble pas être dans les projets immédiats.
Selon vous, l’information dans un monde ultralibéral est une marchandise. Croyez-vous que les médias actuels possèdent encore les pouvoirs nécessaires pour mener à bien leur travail?
Tout ce que les médias cherchent ce sont les cotes d’écoute. Encore là , leur motivation est une question d’enrichissement. Les médias nuisent à l’éducation citoyenne. Rares sont les émissions qui inspirent les citoyens à modifier leurs comportements. L’éducation se fait beaucoup par les médias et ce sont eux qui influencent les gens. Les journaux sont des partisans du néolibéralisme. Je ne dis pas qu’ils ne font pas une mission de temps à autre pour se donner bonne conscience mais le message reste.
Vous êtes fortement engagé auprès de la jeunesse. Quel message livrer aux jeunes générations?
Quand je regarde le nombre de coopératives et d’associations qui se crée, je trouve ça encourageant. Je suis encore professeur associé à l’UQAM et à l’Université de Sherbrooke et je constate que les jeunes comprennent très bien la solidarité. Je ne viens pas parler de théorie, je viens témoigner. Les jeunes sont toujours d’accord avec moi, même si ça finit toujours par : « Est-ce encore possible? » Je leur dit : « Ça dépend de vous. Il faut en avoir les pouvoirs et c’est là -dessus qu’il faut travailler. Comme du temps de la Révolution tranquille. Qu’est-ce qui fait que le Québec a changé en 1960? On a décidé que c’était correct de payer de l’impôt pour l’éducation de tout le monde et pour les soins de santé. On a créé un régime de retraite pour les travailleurs, une caisse de dépôt. À l’invitation du premier ministre Jean Lesage avec son « Maître chez nous! », on a monté un Québec qui a pris sa place dans le monde des affaires. C’était une économie au service de la collectivité. Le Québec est reconnu pour avoir des coopératives dans à peu près tous les secteurs d’activités. Ce n’est pas facile. On doit combattre la cupidité que suggèrent les entreprises à capital-actions mais ces valeurs-là n’ont pas complètement disparues. Au contraire. On les enseigne dans certaines universités. Il y a de l’espoir. Ce ne sont pas les jeunes Québécois qui vont bloquer ce type de projet-là parce que c’est dans leur ADN.
La foi semble avoir guidé vos actes tout au long de votre vie. Avez-vous foi en l’avenir?
Oui. On a de très beaux exemples de coopératives à travers le Québec. Près de Tadoussac, une d’entre elles permet à 300 familles de vivre dignement depuis 30 ans et ça fonctionne. Personne ne cherche à être millionnaire ou milliardaire. C’est ce qui se passe dans bien des milieux mais ça, il faut le raconter.
PRIX ET HONNEURSÂ :
Doctorats
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval
École des hautes études commerciales de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université de Sherbrooke
Université Jean Moulin (Lyon)
- 1990 – Ordre des francophones d’Amérique.
- 1990 – Prix Chomedey-de-Maisonneuve.
- 1992 – Officier de l’Ordre national du Québec.
- 1994 – Membre de l’Ordre du Mérite.
- 2000 РR̩cipiendaire du M̩rite Coop̩ratif qu̩b̩cois d̩cern̩ par le Conseil de la Coop̩ration du Qu̩bec.
- 2003 РR̩cipiendaire du M̩rite Coop̩ratif canadien d̩cern̩ par le Conseil Canadien de la Coop̩ration.
-  2007 Lui est conféré par le Barreau du Québec le titre d’Advocatus Emeritus
-  2014 Grand Officier de l’Ordre national du Québec.

